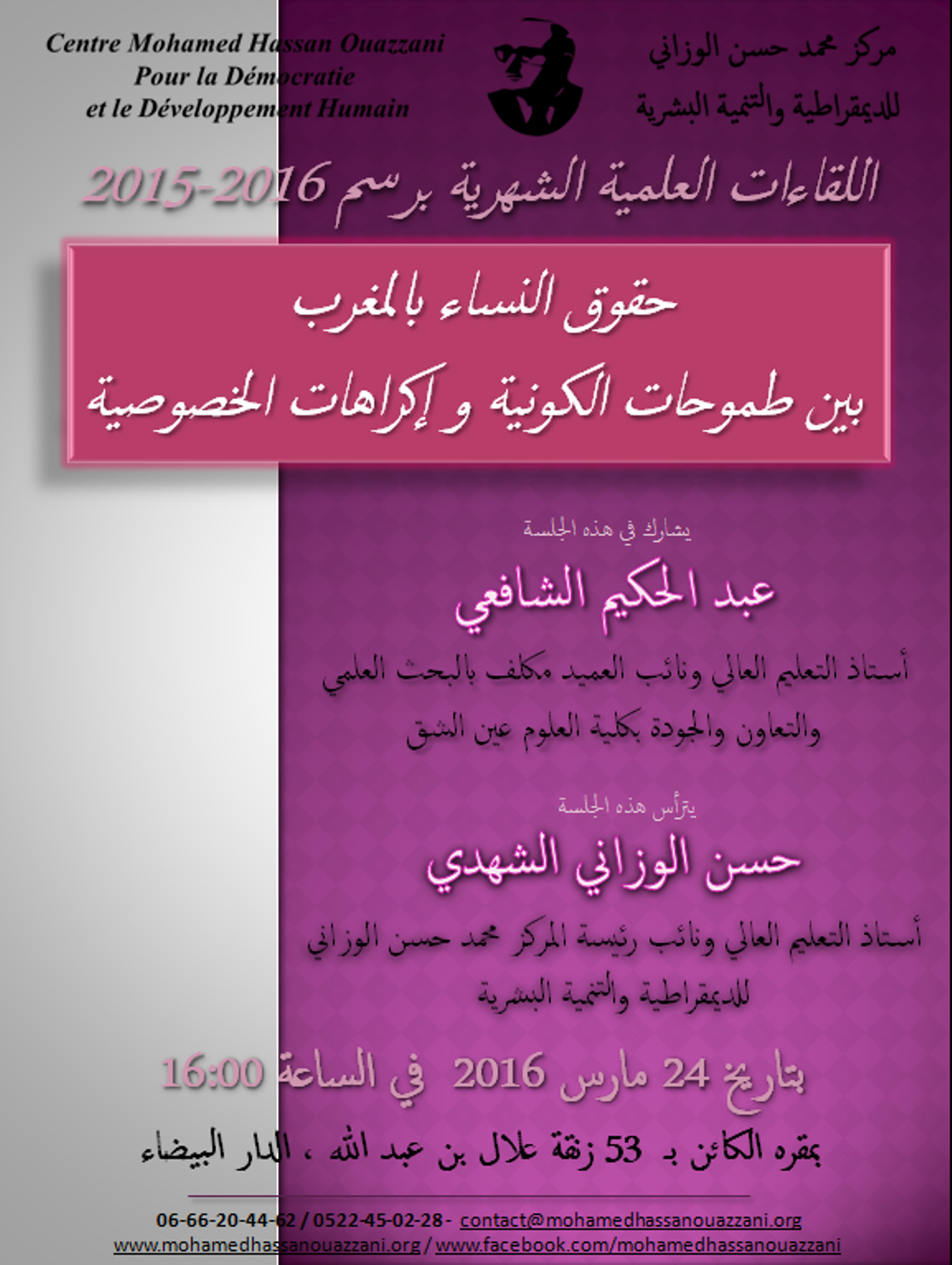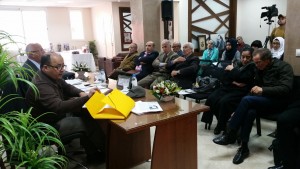Abdelouhab Maalmi est né en 1952 à Fès, Maroc. Il est Docteur d’Etat en sciences politiques de l’Université Bordeaux I, France. Ambassadeur du Maroc au Vatican de 1997 à 2001, professeur depuis 1976 à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Hassan II, Casablanca. Spécialiste des relations internationales, il enseigne la Théorie des relations internationales, la Géopolitique et l’Analyse de la politique étrangère.
Il est Membre fondateur du Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) (Rabat), membre de la commission scientifique de l’Annuaire de la Méditerranéedu GERM(dont il est rédacteur en chef depuis avril 2012), de la revue Islamochristiana (Rome), et ancien rédacteur en chef de la revue Prologues (Casablanca). Il est membre honoraire de l’Accademia Angelica Costantiniana, des Lettres, Arts et Sciences, Rome (novembre 2000) ;Décoré par le Pape Jean-Paul II de la Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX (octobre 1999).
Il a de nombreux travaux de recherches et a donné plusieurs conférences au Maroc et à l’étranger en matière de relations internationales, de géopolitique, de politique étrangère du Maroc, de droit islamique et de dialogue interreligieux. Un intérêt particulier est porté aux problèmes de sécurité et au rôle de l’OTAN en Méditerranée depuis le début des années quatre-vingt-dix dans le cadre du GERM, de l’enseignement et de la recherche (articles et direction de thèses et mémoires). Il a dirigé et présenté en 2012 les Mélanges offerts en l’honneur du professeur Hassan Ouazzani Chahdi soue le titre Droit et mutations sociales et politiques au Maroc et au Maghreb, Paris, éditions Publisud.
ACTIVITES DE RECHERCHES
L’échec de la représentation parlementaire au Maroc, Mémoire de D.E.S, Université Bordeaux I, 1976 ;
Le concept d’influence dans les relations internationales, Thèse d’Etat, Université Bordeaux I, 1985 ;
Vers l’Etat palestinien indépendant, in AR-R’AID (en arabe), 8-9 Rabat, n°6, novembre 1986 ;
Relations Internationales. Concepts et méthodes (en arabe, en collaboration), Toubkal, Casablanca, 1988 ;
Emigration juive soviétique et entente internationale (en arabe), in AL-OUAHDA, Rabat, n°82-83, juin-août 1991 ;
Le système régional arabe face à la crise de la sécurité arabe après la seconde guerre du Golfe (en arabe), in AL-OUAHDA, Rabat, n°73, octobre 1990 ;
Retour au débat sur les origines de la guerre froide, in R.M.D.E.D., Faculté de droit, Casablanca, n° 24 , 1991 ;
Les candidats à la puissance en Méditerranée, in R.M.D.E.D., Faculté de droit, Casablanca, n°24, 1991;
La politique de défense du Maroc : Constances et perspectives d’évolution, in Evolution des politiques de défense des pays du Maghreb, la F.M.E.S., Toulon, 1993 ;
Acteurs et institutions d’une coopération inter-régionale : Andalousie et Nord du Maroc, in R.M.D.E.D., Faculté de droit, Casablanca, n°33, 1994;
Les implications diplomatico-stratégiques pour la Méditerranée de la nouvelle politique de défense de l’OTAN, in R.M.D.E.D., Faculté de droit, Casablanca, n°33, 1994 ;
Les défis transnationaux de la sécurité en Méditerranée Occidentale, in Demain la Méditerranée, F.M.E.S. PUBLISUD, Paris, 1995 ;
L’OTAN et le Sud de la Méditerranée : Les malentendus d’un dialogue, in l’Annuaire de la Méditerranée, G.E.R.M.- PUBLISUD, Paris, 1996 ;
Les nouveaux défis de la sécurité collective et la problématique de la réforme de l’ONU (en arabe), in Un demi-siècle des Nations-Unies, Collection de la Faculté de Droit de Marrakech, n°7, 1997 ;
La rivalité des puissances dans le système international de l’après-guerre froide, in Rapport Annuel sur l’Evolution du Système International, Groupe d’Etudes et de Recherches sur le système International (G.E.R.S.I.), G.E.R.S.I. Publication, Rabat, 1997 ;
L’islamisme à l’épreuve du pouvoir en Turquie : De l’idéologie au réalisme politique, in l’annuaire de la Méditerranée, G.E.R.M-PUBLISUD, Paris, 1997 ;
Guerre et paix dans les Balkans, in l’Annuaire de la Méditerranée, GERM-LE FENNEC, Casablanca, 1999 ;
Etre Ambassadeur auprès du Saint-Siège aujourd’hui (publié en italien et en anglais), in Biblioteca Carita Politica, Editoriale Eco, Rome, 1999 ;
Perspectives d’interprétation pour une réforme du droit de la famille au Maroc : le professeur Ahmed KHAMLICHI comme modèle (en arabe), in Les possibilités d’une herméneutique favorable à une réforme substantielle du droit de la famille, Prologues, n° 4 hors série, 2003, Casablanca ;
Monde musulman, Occident et lutte contre le terrorisme, in Occident-monde musulman après 11 septembre : réflexions du Nord et du Sud, Prologues, n°24 – 2003, Casablanca ;
L’ONU et la persistance des guerres régionales et locales, in Les guerres locales et régionales et leurs conséquences sur le développement, la civilisation et la paix dans le monde, in Publications de l’Académie du Royaume du Maroc, session d’automne 2002, Rabat 2002 ;
Perceptions et perspectives des relations entre le Maroc et l’Espagne, in Annuaire de la Méditerranée 2002, G.E.R.M., Rabat ;
Les élections législatives du 27 septembre 2002 au Maroc ; Quelle transition ? , in Annuaire de la Méditerranée 2002, G.E.R.M., Rabat ;
Les grandes problématiques du Partenariat euro-méditerranéen, in Annuaire de la Méditerranée 2005, G.E.R.M, Rabat.
Les constitutions arabes et la Shari’a, in Islamochristiana, n° 32, 2006, PISAI, Rome ;
Les variables externes des transitions démocratiques en Méditerranée : Le cas des pays du Maghreb, in Annuaire de la Méditerranée 2006, GERM, pp. 61-76.
La Méditerranée occidentale comme un complexe de sécurité : Implications pour la sécurité nationale du Maroc, Annuaire de la Méditerranée 2007, GERM, pp. 55-74.
Le dialogue interreligieux du point de vue des relations internationales : Le cas des relations entre le Vatican et les Etats arabes et musulmans, in Abdelhak Azzouzi (dir.), Figures et valeurs du dialogue des civilisations et des cultures, L’Harmattan, vol. 3, 2008, pp.149-166
Les constitutions arabes et les droits humains universels, in Gianluca Sadun Bordoni (dir.), Diretti del’Uomo e dialogo méditerraneo, Milano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 33-50
Les bases géographiques de la politique étrangère du Maroc, in Le Maroc et les mutations internationales (ouv. collectif), Université Hassan II-Ain Chock, Facultés des Lettres et des Sciences Humaines de Casablanca, Actes n° 22, 2010, pp. 57-84.
Où en est la Théorie des relations internationales aujourd’hui ? in Variations sur le système international, Mélanges offerts en l’honneur du Professeur Mohamed Lamouri, coll. Réforme du Droit et Développement social et économique, n° 3, 2010, pp. 271-336.
Maroc-Vatican : Le choix du dialogue, Rev. Zamane, n° 15, janvier 2012, Rabat, pp. 74-79.
La formation de la politique étrangère du Maroc : Le temps fondateur (1956-1963), in Droit et mutations sociales et politiques au Maroc et au Maghreb, Mélanges offerts en l’honneur du Professeur Hassan Ouazzani Chahdi, Publisud, 2012.
La politique étrangère de Mohammed VI dix ans après, in Droit et mutations sociales et politique au Maroc et au Maghreb, Mélanges offerts en l’honneur du Professeur Hassan Ouazzani Chahdi, Publisud, 2012.
Coordination et présentation des Mélanges offerts en l’honneur du Professeur Hassan Ouazzani Chahdi, Droit et Mutations sociales et politiques au Maroc et au Maghreb, Publisud, 2012.
Convergences des politiques juridiques pour un développement commun dans l’espace euro-méditerranéen, Rapport de synthèse in Actes du Séminaire international organisé à la Faculté de droit de Casablanca, REMALD, collection Thèmes actuels, n° 81, 2012, pp 265-269 ;
Bouleversements politiques arabes : quelle nouvelle géopolitique en Méditerranée ? in L’Annuaire de la Méditerranée 2010-2011, GERM/Fondation Friedrich Ebert, pp. 11-20 ;
CESE et seconde Chambre au Maroc : Quelle articulation ?, in
L’Annuaire de la Méditerranée 2010-2011, GERM/Fondation Friedrich Ebert, pp.69-76;
Le groupe de Visegrad : quelle leçon pour les pays du Maghreb !?, in L’Annuaire de la Méditerranée 2010-2011, GERM/Fondation Friedrich Ebert, pp. 97-104 ;
Bilatéralisme et multilatéralisme dans les relations de l’OTAN avec les pays du Maghreb, in L’Annuaire de la Méditerranée 2010-2011, GERM/Fondation Friedrich Ebert, pp. 111-126
Plusieurs articles sur des sujets de politique interne ou internationale parus dans le journal AL-ITTIHAD ICHTIRAKI notamment, entre 1986 et 1997 ; Plusieurs interview accordées à la presse marocaine (Al Watane, Akhbar al Youm, Le Matin, etc..).
Plusieurs notes de lecture dans la revue PROLOGUES (Bulletin du Livre sur le Maghreb) ;
AUTRES ACTIVITES
Membre du comité exécutif du Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée (G.E.R.M.) ;
Membre fondateur de l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel (A.M.D.C.) ;
Membre fondateur de la Société Marocaine de Droit de l’Environnement (S.O.M.A.D.E.) ;
Directeur de la rédaction de la revue Prologues (Bulletin du Livre sur le Maghreb) de janvier 2002 à septembre 2003 ;
Membre du comité scientifique et rédacteur en chef de l’Annuaire de la Méditerranée, G.E.R.M.
Membre du comité de rédaction de la Revue marocaine de droit du développement économique, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Casablanca ;
Membre du comité scientifique de la Revue Prologues – Casablanca ;
Membre de l’Editorial Board de la revue Islamica-Christiano, Institut pontifical pour les études arabo-islamiques (PISAI), Rome ;
Membre de la commission scientifique de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales depuis 2003.
Membre de la commission administrative du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (S.N.E.S.U.P.) du 4ème au 6ème Congrès National.
Participation à plusieurs colloques et séminaires nationaux et internationaux ;
CONSULTATIONS ET MISSIONS
Consultation au profit du P.N.U.D. et du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour une étude sur l’action du système des Nations-Unies au Maroc, par l’intermédiaire du G.E.R.M ;
Consultation au profit de la fondation du Roi Abdul-Aziz Ibn Saoud pour les Etudes islamiques et les sciences humaines (Etude sur l’état des lieux de la Fondation après 5ans d’existence), 1990 ;
Mise en place, en tant que chef de poste, de la première ambassade résidente du Maroc auprès du Saint-Siège (Vatican) à Rome, 1997-2001.
Mission au Nigeria au profit de l’U.S.F.P. et de l’Internationale socialiste pour une enquête sur l’application de la Charia en matière pénale dans certains Etats nigérians musulmans (novembre 2002).
DISTINCTIONS
Membre honoraire de l’Accademia Angelica Costantiniana, des Lettres, Arts et Sciences, Rome (novembre 2000) ;
Décoré par le Pape Jean-Paul II de la Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX (octobre 1999).